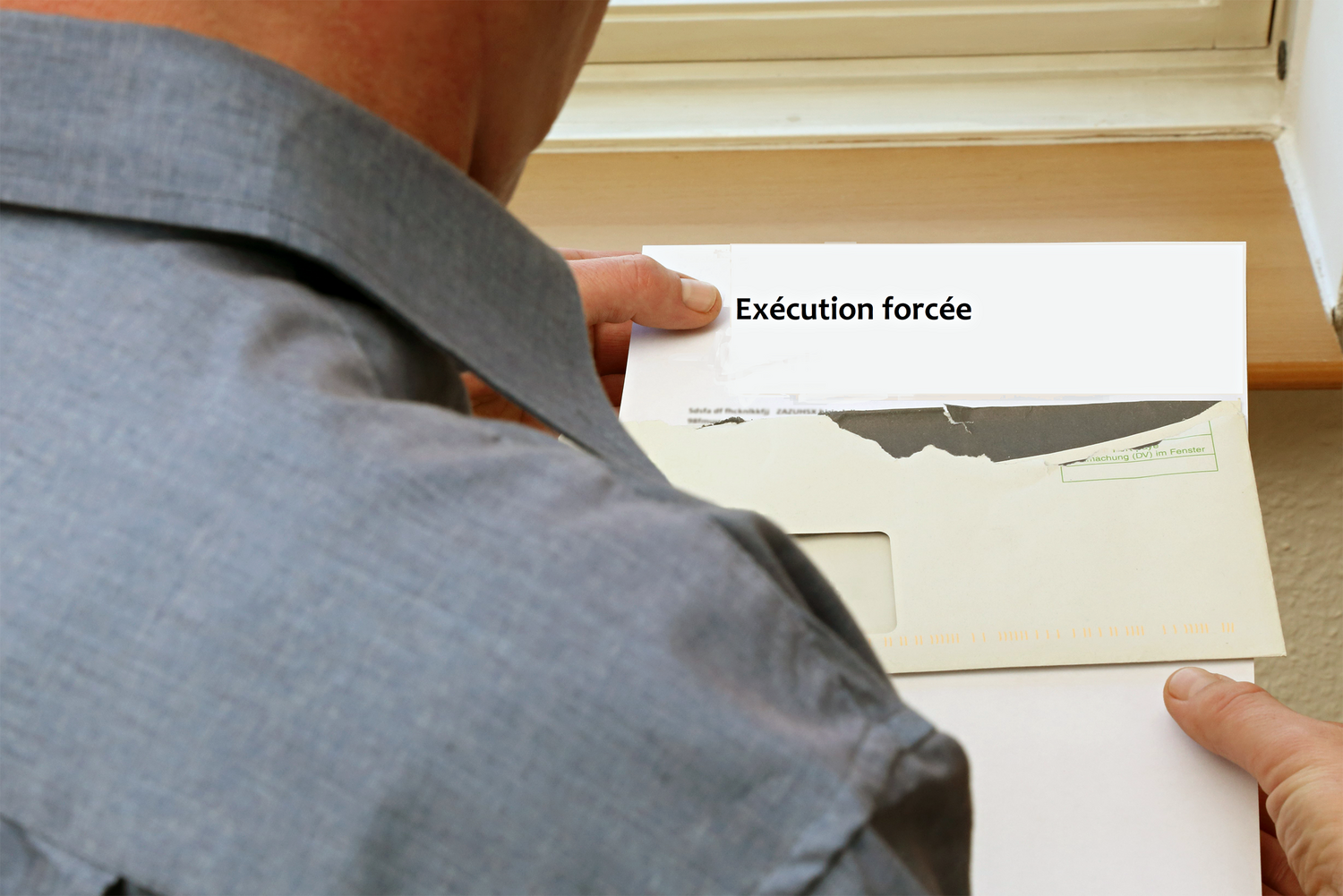
La prévention grâce à la suppression des facteurs structurels d’endettement
En Suisse, certains cadres juridiques et structurels contribuent au maintien d’un endettement durable. Plusieurs projets de réforme visant à les redéfinir sont en cours, mais leur adoption demeure incertaine face aux équilibres politiques actuels.
Contrairement aux pays voisins, la Suisse ne connaît ni prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, ni prélèvement automatique des cotisations d’assurance-maladie. Dans le canton de Zurich, ces deux postes représentaient respectivement 17,3 % et 21,1 % de l’ensemble des poursuites engagées en 2024. Un autre facteur favorisant l'endettement réside dans le fait que, dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital prévu par le droit des poursuites. À l’issue de l'année de saisie, la personne endettée se retrouve donc inévitablement avec une facture fiscale impayée. La situation est aggravée par la durée exceptionnellement longue de prescription des actes de défaut de biens en Suisse, fixée à 20 ans (elle était même imprescriptible jusqu'à fin 1996). De plus, un tel acte peut faire l'objet d'une nouvelle procédure de recouvrement à tout moment, ce qui interrompt à chaque fois le délai de prescription – le rendant de facto imprescriptible. La gestion systématique et prolongée des dettes peut ainsi devenir particulièrement rentable pour certains créanciers. Enfin, il convient de souligner qu’à l’inverse de nombreux pays d’Europe occidentale — ainsi que des États-Unis — la Suisse ne prévoit actuellement aucune procédure de libération des dettes résiduelles.
Prise en compte des impôts dans le calcul du minimum vital prévu par le droit des poursuites
Depuis les années 1890, la prise en compte des impôts n'était pas considérée comme « indispensable » (art. 93 LP) au débiteur et à sa famille. Une telle appréciation s’inscrit, sans surprise, dans une perspective à la fois sociale et politique. Il est toutefois indéniable qu'à l'époque, une saisie pouvait en général être couverte par la réalisation d'un bien matériel (p. ex. un meuble), tandis que la saisie sur salaire demeurait statistiquement marginale. Avec la perte de valeur marchande des biens matériels, cette situation s'est progressivement inversée pour mener à des saisies sur salaire répétées, pouvant s’étendre sur plusieurs années.
La proposition d’intégrer les impôts dans le calcul du minimum vital prévu par le droit des poursuites a reçu, il y a un an, un large soutien tant au Conseil national qu’au Conseil des États. Sa mise en œuvre reste toutefois complexe : quel montant exact inclure dans ce minimum vital, sachant que la charge fiscale n’est déterminée qu’a posteriori, tandis que l’acte de saisie est déjà établi ? Cette problématique devrait être abordée de manière analogue à celle du prélèvement de l’impôt à la source pour les personnes titulaires d'un permis de séjour. Cependant, la nécessité d’une procédure de poursuite simple et rapide entre en conflit avec l’idée d’une redistribution ultérieure (d’un éventuel excédent) en faveur d’un créancier prioritaire.
Procédure de libération des dettes résiduelles
La Commission des affaires juridiques du Conseil national examine actuellement la proposition du Conseil fédéral visant à introduire une procédure de libération des dettes résiduelles pour les particuliers. Comme évoqué précédemment, la Suisse ne connaît pas encore un tel dispositif, alors même qu’il serait particulièrement pertinent dans notre pays. Outre des adaptations apportées à la procédure concordataire simplifiée (art. 331a à 331g LP), le projet prévoit notamment une nouveauté importante : l'absence de réponse d'un créancier à une procédure concordataire serait désormais considérée comme une acceptation (art. 331g, let. A). Il s’agit d’une modification certes modeste, mais susceptible d’améliorer concrètement l’efficacité de la procédure.
En guise de réforme majeure, le Conseil fédéral propose également l’introduction d’une nouvelle procédure concordataire en cas d'insolvabilité s’appliquant aux personnes physiques : après l'ouverture judiciaire d'une période de saisie du salaire de trois ans, les créances encore exigibles à l’issue de la procédure devraient pouvoir être annulées légalement, rendant ainsi les actes de défaut de biens non exécutoires — à condition que la personne concernée n’ait pas contracté de nouvelles dettes durant cette période. Cette libération judiciaire des dettes serait toutefois soumise à plusieurs conditions : le débiteur doit satisfaire à son obligation de renseigner, de remettre les objets, de coopérer et d'informer. Il doit par ailleurs démontrer que les efforts qu’il a déployés pour générer des revenus et gains ne peuvent être considérés comme manifestement insuffisants.
Une condamnation pour des infractions liées à la faillite ou aux poursuites survenue dans les dix années précédant la procédure constituerait un motif d’exclusion de la procédure de libération des dettes résiduelles. Le projet prévoit également des exceptions clairement définies : ainsi, il exclut d’emblée l'effacement des dettes liées à des contributions d'entretien relevant du droit de la famille, sauf si ces créances ont été prises en charge par la collectivité publique. La même règle s’applique aux amendes, peines pécuniaires, indemnités pour tort moral ou demandes de remboursement de prestations d'aide sociale perçues indûment. En outre, tout apport patrimonial ultérieur (héritage, donation, etc.) intervenant dans un délai de cinq ans serait intégré rétroactivement dans la masse en faillite. Le Conseil fédéral estime à juste titre avoir proposé un compromis équilibré et équitable.
Réglementation des demandes en dommages-intérêts pour retard :
Enfin, il convient de mentionner un autre facteur favorisant l’endettement : en cas de retard de paiement, les sociétés de recouvrement, entre autres, réclament souvent des dommages-intérêts pour retard de paiement qui peuvent être très élevés et viennent s’ajouter à la créance initiale. Lorsqu'un débiteur a payé la créance principale et demande au créancier de retirer la procédure de poursuite, il est fréquemment tenu de régler ces frais supplémentaires au préalable. Pour remédier à cette pratique, le conseiller national Vincent Maître a déposé une motion intitulée « Encadrer et plafonner les frais des sociétés de recouvrement ». Le Conseil national s'est récemment prononcé en faveur de ce mandat législatif, actuellement en cours d’examen par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États. La motion reste toutefois controversée. Ses opposants estiment que les dommages-intérêts pour retard ne sont pas juridiquement fondés et rejettent donc l’initiative. Ce faisant, ils offrent un soutien indirect aux sociétés de recouvrement, entravant la mise en place d’une solution pourtant urgente.
Gestion démesurée des créances
Un nouveau phénomène, désormais largement répandu dans le commerce en ligne, suscite de vives inquiétudes : parmi les options de paiement proposées figure, depuis quelque temps, un établissement financier (en réalité une banque) qui devient immédiatement créancier dès la validation de l'achat en lieu et place du commerçant en ligne. Les internautes, pour la plupart de jeunes adultes, sont fortement incités à recourir à ce mode de paiement à l’aide de slogans séduisants du style « Nous sommes là pour résoudre vos problèmes » et d’une forte présence publicitaire sur les réseaux sociaux. L'analyse des réquisitions de poursuite révèle toutefois une réalité bien différente : dans la grande majorité des cas, les dommages-intérêts réclamés pour retard de paiement sont exorbitants ! Il apparaît clairement que le rachat de créances impayées ne vise qu’un objectif : exploiter de manière implacable les débiteurs, dans une logique de rentabilité maximale au détriment des consommateurs.
Gestion publique des actes de défaut de biens
C'est précisément parce que les sociétés de recouvrement et les institutions financières internationales sont perçues par les débiteurs comme des acteurs qui se contentent de gérer les problèmes sans les résoudre véritablement que les actes de défaut de biens émis par les assureurs-maladie (mais aussi par les administrations fiscales) ne devraient pas être confiés à des sociétés de recouvrement privées. En effet, la gestion privée de ces actes constitue clairement un facteur aggravant l'endettement.
Les projets de loi actuellement en discussion visent à atténuer les conditions structurelles de l'endettement évoquées en introduction. D'un point de vue pratique, il est judicieux de poursuivre dans cette direction, en veillant à élaborer des solutions à la fois convaincantes, durables et simples à mettre en œuvre.